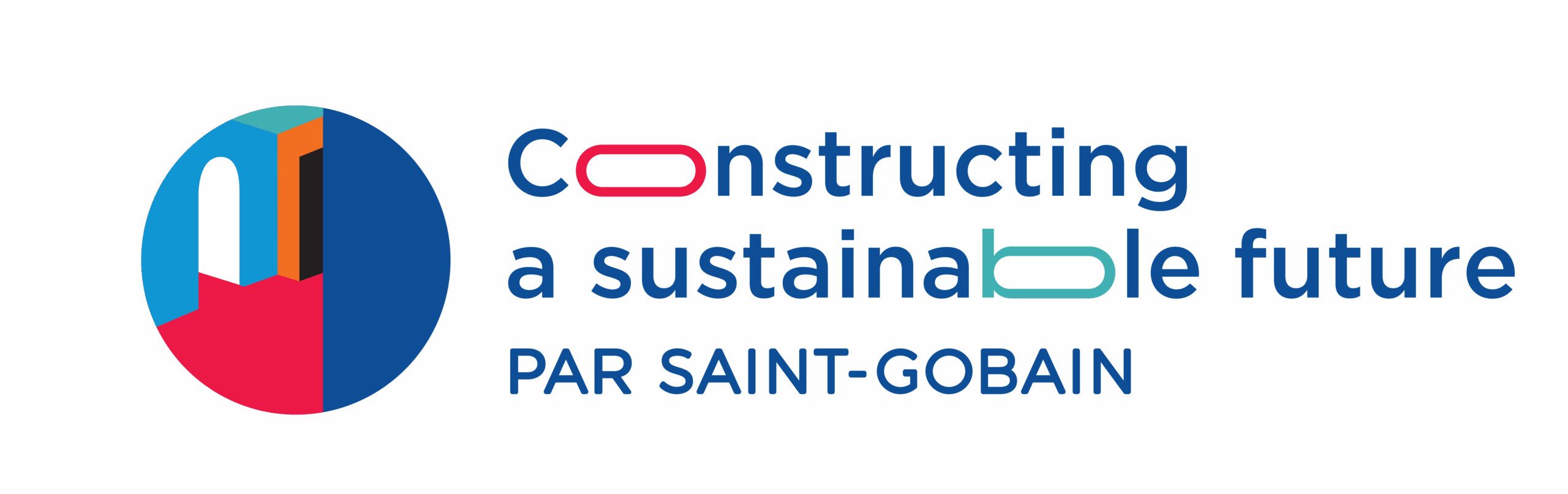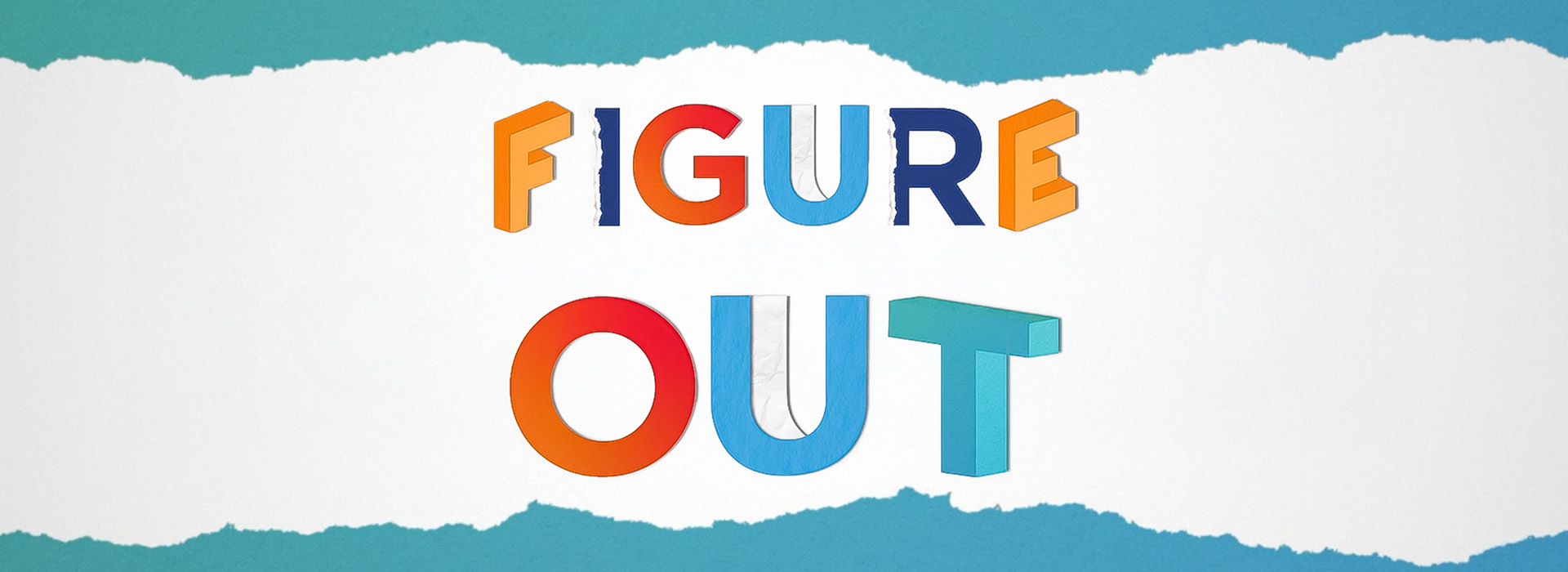6 min
6 min
Quels leviers considérez-vous comme essentiels pour à la fois réduire l’impact environnemental du bâtiment et renforcer l’équité sociale(1) ?
Je distingue deux points essentiels pour faire rimer durable et abordable.
Le premier concerne le coût des matériaux de construction durable qui tend à diminuer. Autrefois, il existait une corrélation entre durabilité et coût élevé des matériaux. Heureusement, cet écart se réduit, et même si le coût d’entrée reste encore parfois plus élevé, l’entretien à long terme est moins coûteux.
C’est une évolution positive car la durabilité devient économiquement rationnelle, pas seulement éthique.
Mon second point concerne le rôle du foncier et l’importance du « zonage ». Les terrains déjà dotés d’infrastructures et de services sont généralement les plus chers. Le vrai défi, c’est donc d’aligner la construction — neuve ou rénovée — avec la localisation.
Cela renvoie directement à la vision d’ensemble de la ville : quelle ville voulons-nous construire ? Comment les nouveaux bâtiments s’y intègrent-ils ?
Au Brésil, par exemple, de nombreuses villes ont instauré des zones d’intérêt social. Ces secteurs regroupent des quartiers informels qui peuvent être réaménagés grâce à de nouvelles constructions ou à la densification. Dans certains cas, cela signifie bâtir de nouveaux logements ; dans d’autres, réutiliser des espaces vides ou sous-exploités à l’intérieur même de la ville.
Qu’en est-il de l’équilibre entre coût et accessibilité d’une part, et qualité du logement d’autre part ?
Nous observons des progrès dans la prise de conscience de l’importance de la qualité, mais cela reste un défi tant les besoins sont immenses. Si l’on se replonge dans le passé, de nombreux programmes massifs ont privilégié la quantité au détriment de la qualité. Au Mexique, d’immenses ensembles de logements ont ainsi été construits dans les années 1990, mais leur emplacement et leur qualité ne correspondaient souvent pas aux besoins des habitants.
Aujourd’hui, nous comprenons beaucoup mieux l’importance de la qualité, surtout quand les catastrophes liées au climat deviennent plus fréquentes et plus graves. Prenons les séismes : nous ne pouvons pas continuer à reconstruire après chaque désastre. Il faut concevoir dès le départ des logements plus résilients.
C’est là que se rejoint la justice sociale et le climat : garantir non seulement un toit, mais un logement sûr, durable et digne.

Amérique latine : 4 exemples qui ont amélioré
la qualité de vie des habitants tout en réduisant l’impact environnemental
Au Brésil
Quand le secteur privé fait progresser la justice sociale en répondant aux défis environnementaux
Une entreprise d’électricité qui travaillait dans l’une des favelas les plus connues de Rio, Santa Marta a décidé de lier les factures d’électricité à un programme de recyclage : les habitants apportaient leurs déchets recyclables deux fois par semaine, gagnaient des points et pouvaient utiliser ces points pour payer leurs factures. Cela a restauré un sentiment de dignité sociale.

S’attaquer aux favelas
Le Programme d’Accélération de la Croissance, lancé en 2007, a transformé de nombreuses favelas dans les zones métropolitaines. Leurs interventions ont permis un accès quasi universel
à l’électricité, l’intégration de réseaux d’eau et une meilleure connexion avec le reste de la ville. Elles ont également inclus des équipements culturels et sportifs, car les habitants ont besoin non seulement d’infrastructures, mais aussi de vie sociale et d’interactions.
Argentine
Améliorer les quartiers informels avec des infrastructures modernes et résilientes
La ville de Buenos Aires, soutenue par le gouvernement national, rénove depuis une dizaine d’années des quartiers informels. Le processus commence par la cartographie des besoins et priorités des communautés, puis la co-conception de solutions avec elles. Dans un de ces quartiers, un nouveau bâtiment résidentiel a été construit avec des panneaux solaires et d’autres éléments durables.
Colombie
Connecter les quartiers d’une ville pour réduire les inégalités sociales
Dans la ville de Medellín, un téléphérique a été construit pour relier les quartiers situés sur les collines au reste de la ville. Cela s’est accompagné d’une nouvelle architecture et d’infrastructures adaptées.

(1) Définitions :
- Équité (dans la construction durable) : garantir que les projets de construction répondent de manière juste aux besoins de toutes les populations, en tenant compte des inégalités sociales, économiques et territoriales.
- Justice sociale (dans la construction durable) : viser une répartition équitable des bénéfices et des impacts du développement urbain, afin que chacun ait accès à un cadre de vie sain, sûr et abordable.