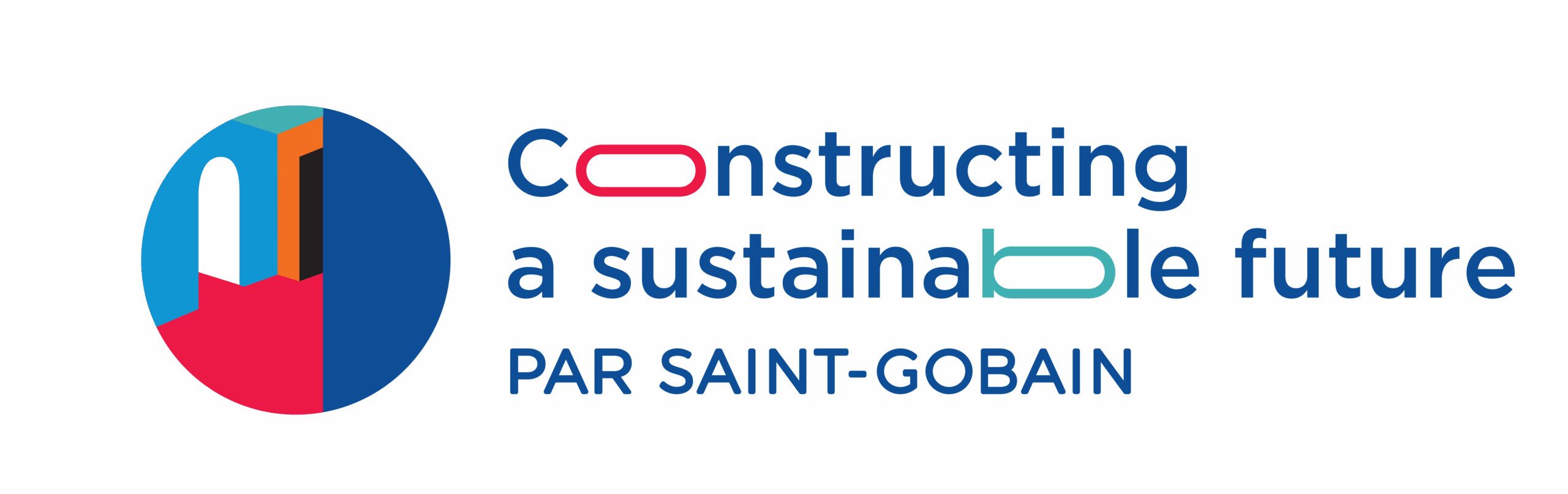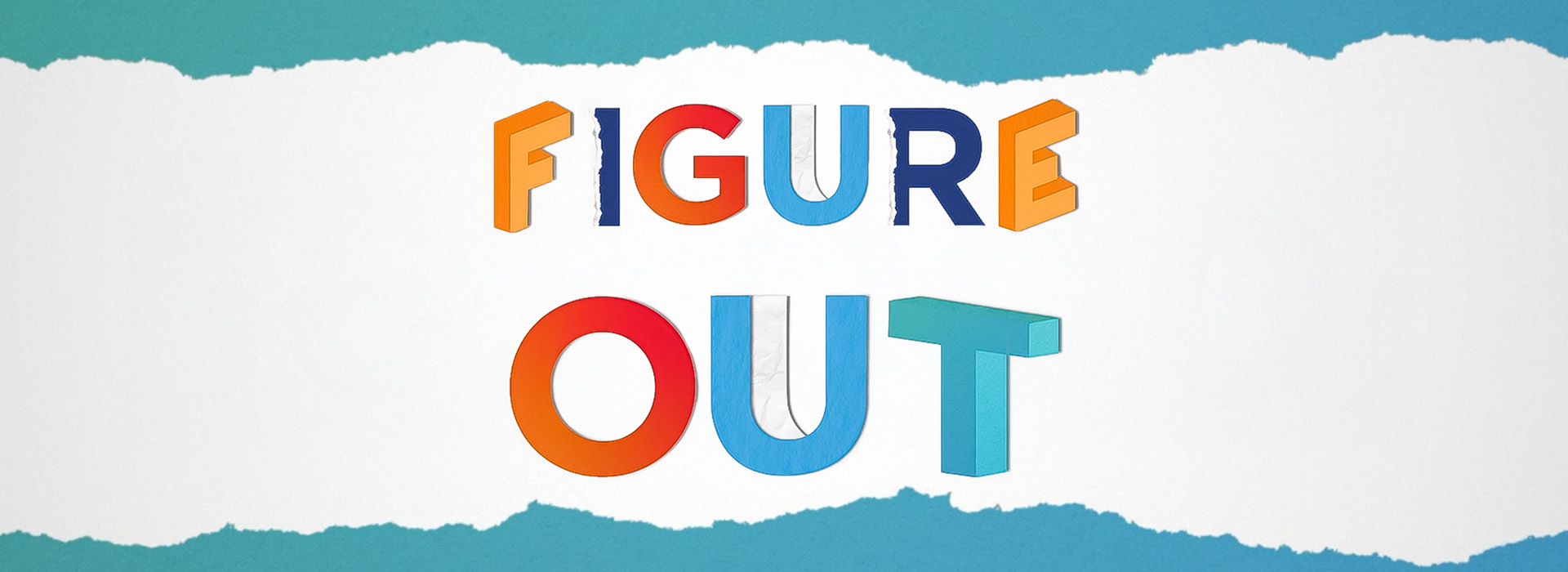11 min
11 min
Fini le temps où le confort thermique se résolvait par l’ajout d’équipements de chauffage ou de climatisation. L’heure est à l’anticipation et à la conception de bâtiments intrinsèquement adaptés aux aléas climatiques, présents et à venir. Une course à l’innovation qui mobilise architectes, ingénieurs et industriels.
Penser confort dès la genèse du projet
Le confort thermique se conçoit dès les premières esquisses, armé d’outils de simulation qui révolutionnent la conception des projets. Leur but : placer l’anticipation climatique au cœur de chaque décision architecturale.
Les logiciels de simulation thermique dynamique (STD) sont ainsi capables de tester virtuellement le comportement d’un bâtiment selon différents scénarios climatiques. Un outil comme IES VE par exemple simule les conditions climatiques à chaque instant de l’année, permettant aux concepteurs d’analyser l’impact des variations temporelles sur le confort thermique et la consommation énergétique. Grâce à cette approche prospective, les dépenses opérationnelles sont réduites de 20 à 40 % sur le cycle de vie du bâtiment.
Le generative design boosté par l’IA amplifie cette révolution en explorant automatiquement des centaines de configurations possibles. Orientation optimale pour capter les brises d’été tout en maximisant les apports solaires hivernaux, dimensionnement des protections solaires selon l’évolution de la course du soleil, calcul de l’inertie thermique idéale… Les algorithmes testent, comparent et proposent des solutions que l’intuition seule n’aurait pas imaginées.
Il s’agit de créer des bâtiments adaptatifs, capables d’évoluer avec les conditions climatiques sans compromettre le confort des occupants ni alourdir leur empreinte énergétique. Une philosophie architecturale qui fait de la résilience thermique le nouveau standard de la construction durable.
La résilience thermique, nouveau standard de la construction durable.The Edge à Amsterdam (Pays-Bas), avec son score BREEAM record de 98,4 %, illustre cette approche : chaque façade est différenciée selon son orientation, l’atrium nord maximise la lumière naturelle tandis que les panneaux solaires sud protègent des surchauffes, et un système aquifère stocke la chaleur estivale à 130 mètres de profondeur pour la restituer en hiver.

À Grenoble (France), la résidence Ginkgo pousse cette logique d’adaptation climatique dans un contexte alpin. Lauréate des Trophées du Bâtiment Passif 2024 et détentrice du label PassivHaus, cette tour de dix étages, imaginée par l’agence PPX, révèle une sophistication discrète : une double peau horizontale et verticale masque le rayonnement solaire, même bas, empêchant la façade de s’échauffer. Combinée à une isolation par l’extérieur renforcée, cette conception élimine les ponts thermiques et crée une inertie thermique permettant de généreuses ouvertures vers le paysage montagnard sans compromettre la performance énergétique. Le projet se passe entièrement de climatisation grâce à un système géothermique utilisant la nappe phréatique et un dispositif de rafraîchissement passif « free cooling ».

Un confort qui passe par le choix des matériaux
Aux outils de conception innovants répond une transformation tout aussi essentielle des matériaux eux-mêmes.
Les vitrages intelligents ont fait évoluer la gestion des apports solaires. Les verres électrochromes s’opacifient automatiquement selon l’intensité lumineuse, tandis que les vitrages à contrôle solaire sélectif laissent passer la lumière tout en bloquant la chaleur infrarouge.
Le campus Ananta de Google à Bengaluru, inauguré en mars 2025, témoigne de ces avancées : ses 19 000 m² de vitrage dynamique SageGlass constituent la plus grande installation de vitrage intelligent au monde. Capable de moduler le blocage de la lumière de 60 % (état clair) à 99 % (teinte maximale) et de filtrer 96 % de la chaleur solaire, ce vitrage intelligent permet de réduire de 20 % en moyenne la charge énergétique globale du bâtiment tout en préservant la luminosité naturelle et la vue extérieure.

Les matériaux à changement de phase (paraffine, polymère, acide gras…), autrement appelés MCP bien qu’identifiés depuis plusieurs décennies, continuent de faire l’objet de nombreuses recherches et expérimentations dans le secteur de la construction et ouvrent des perspectives intéressantes. Leur capacité à stocker et restituer la chaleur selon les variations de température en fait des alliés précieux pour améliorer le confort thermique de manière passive, sans consommation énergétique supplémentaire. Intégrés dans les parois, les plafonds ou les isolants, les MCP absorbent la fraîcheur nocturne et la relâchent en journée, contribuant ainsi à lisser les pics de température et à limiter le recours à la climatisation mécanique.
Plusieurs projets récents permettent d’explorer leur potentiel dans des contextes variés. C’est le cas de MCP-iBAT, un projet porté par plusieurs institutions françaises à La Réunion et financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Ce dernier vise à développer des matériaux à changement de phase adaptés au climat tropical humide. Intégrés à l’enveloppe du bâtiment, ces MCP augmentent l’inertie thermique des parois tout en valorisant des coproduits industriels locaux pour créer une filière réunionnaise.
Les matériaux à changement de phase stockent la fraîcheur nocturne pour la restituer en journée, créant une climatisation naturelle.
À noter que l’adoption de ces innovations est accélérée par le développement de la construction hors site et le recours au préfabriqué : les modules préfabriqués permettent en effet d’intégrer en usine des solutions techniques complexes, garantissant leur performance tout en réduisant les délais de mise en œuvre. Cette approche industrielle démocratise l’accès aux technologies de pointe du confort thermique.
De l’importance des solutions locales et traditionnelles
Mais ces innovations matérielles, si performantes soient-elles, ne sauraient masquer une réalité fondamentale : le confort thermique ne se décrète pas de manière universelle. Il se construit en dialogue avec son territoire, ses ressources et sa culture climatique. Cette approche contextuelle inspire aujourd’hui les projets les plus innovants, qui puisent dans les savoirs vernaculaires (locaux et traditionnels) pour inventer l’architecture thermique de demain.
En région méditerranéenne, l’architecture vernaculaire inspire de nouvelles approches climatiques. Les projets contemporains revisitent les techniques traditionnelles : murs épais en pierre locale pour l’inertie thermique, patios intérieurs pour la ventilation naturelle par effet de cheminée, toitures plates pour la collecte des eaux pluviales. Ces éléments architecturaux, adaptés aux spécificités du climat méditerranéen, créent des espaces frais sans climatisation mécanique.
Cette adaptation locale ne signifie pas isolement technologique. Les projets les plus réussis combinent savoirs traditionnels et innovations, créant une synthèse unique entre héritage climatique et performance moderne.
Le Campus Alnatura à Darmstadt (Allemagne) illustre parfaitement cette approche hybride. Celui qui est considéré comme le plus grand bâtiment administratif européen, marie façades en terre battue, un matériau ancestral, avec des technologies de pointe. Les murs en terre battue, dont une grande partie provient du chantier du tunnel & Stuttgart21 dans une démarche d’économie circulaire, intègrent un système radiatif (1) moderne pour le chauffage et le refroidissement. Cette technique ancienne fonctionne en synergie avec des sondes géothermiques, des panneaux photovoltaïques, une ventilation naturelle assistée par capteurs CO₂… Le résultat : un bâtiment performant qui optimise le confort thermique en combinant l’inertie naturelle de la terre avec l’intelligence des systèmes contemporains.

Concevoir un bâtiment aujourd’hui, c’est anticiper les climats de 2050 et au-delà, intégrer l’innovation matérielle et puiser dans les savoir-faire vernaculaires pour concevoir des solutions de confort thermique inédites. C’est aussi accepter que le confort ne se standardise pas, mais s’adapte, se module et évolue avec son environnement. Le confort thermique incarne ainsi une nouvelle philosophie du bâti, où frugalité, résilience et habitabilité se conjuguent pour redéfinir l’architecture de demain.
(1) Un système radiatif est un dispositif de chauffage et/ou de refroidissement qui fonctionne par rayonnement thermique, plutôt que par convection (comme un radiateur soufflant ou un climatiseur classique). Il chauffe ou refroidit par l’émission ou l’absorption de chaleur, directement entre les surfaces (plafonds, murs, sols) et les corps présents dans la pièce, sans mouvement d’air important.
Pour aller plus loin :
IES VE : https://www.iesve.com/fr/decouvrir/simulation-thermique-dynamique-std
The Edge Amsterdam: https://edge.tech/buildings/the-edge
Alnatura Campus : https://transsolar.com/fr/projects/alnatura-campus
Lire/Ecouter aussi :
« La beauté doit être le résultat de la durabilité »
Podcast :
E… comme Efficacité énergétique
Les bonnes pratiques de l’efficacité énergétique
Santé et bien-être : un enjeu de la construction durable