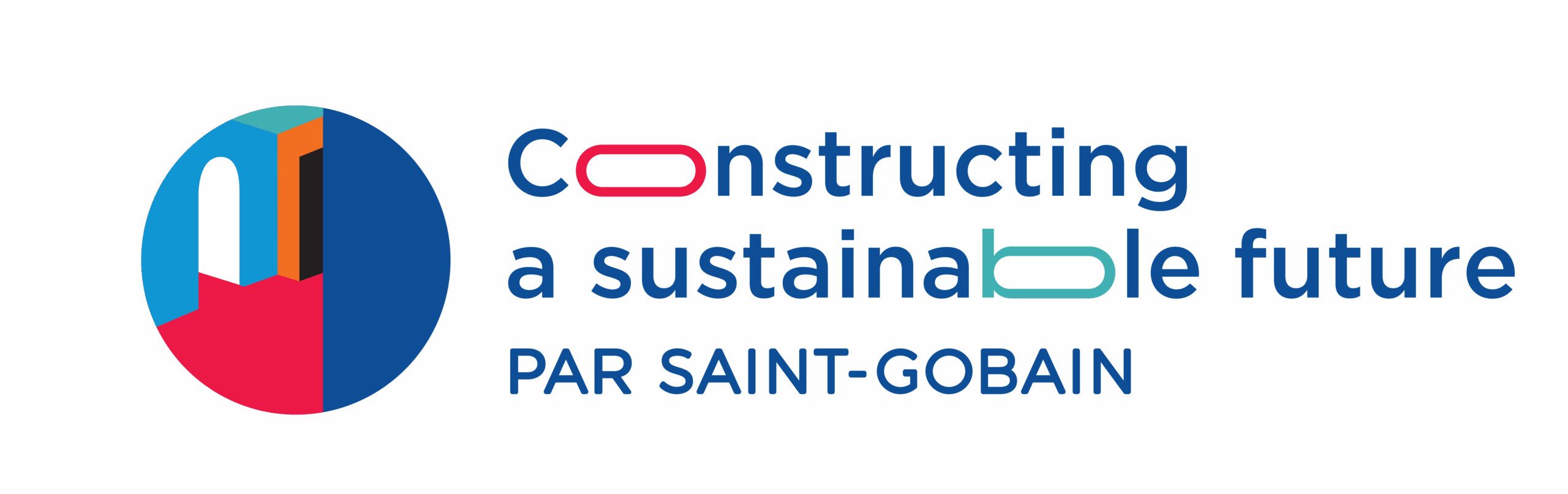7 min
7 min
Vous défendez une approche exploratoire de la « circularité sur site ». En quoi cela consiste-t-il et quel est selon vous son potentiel de développement ?
Notre approche va au-delà de la simple circularité. Je vois les bâtiments comme des organismes vivants capables de s’autorégénérer en utilisant leurs propres ressources.
Aujourd’hui, nous distinguons deux approches dans la circularité des matériaux recueillis directement sur site : le réemploi direct d’éléments entiers (poutres, plaques de béton) et la revalorisation de débris transformés en nouveaux matériaux. L’enjeu est de déterminer à quelle échelle l’effort de revalorisation reste justifiable.
Le potentiel d’adoption de notre approche de circularité sur site est selon moi important, carl’industrie est en pleine transition vers des pratiques plus durables, tandis que les outils techniques évoluent rapidement. Par exemple, les scans par impulsion ultrasonique, que nous avons utilisés pour les recherches du Pavillon Danois à la Biennale de Venise, sont en train d’être transformés en outils industrialisables. Ils permettent d’analyser instantanément les propriétés structurelles des matériaux – capacité de charge, résistance à la traction – et de leur trouver une nouvelle utilité.
L’intelligence artificielle accélérera bientôt le traitement de ces données, réduisant considérablement le temps d’analyse. Le principal défi reste là, d’ailleurs, le temps. Mais d’ici à quelques années, les technologies seront beaucoup plus accessibles et efficaces et les nouveaux usages qui se dessinent aujourd’hui auront eu le temps de fleurir.

Quelles caractéristiques font, selon vous, qu’un matériau est idéal pour le réemploi ?
C’est essentiellement une question d’échelle et de robustesse. Un matériau réemployable doit pouvoir être utilisé à grande échelle, et ce, malgré ses imperfections – coins ébréchés ou couleurs non uniformes. Pour cela, nous devons abandonner notre vision standardisée de la construction pour valoriser ces traces d’histoire.

Comment faciliter la réutilisation future des composants d’un bâtiment dès sa conception ?
Nous devons maîtriser deux approches complémentaires : soit créer des composants (éléments de la construction tels que des cloisons) facilement démontables et réutilisables tels quels, soit concevoir des systèmes permettant de transformer des débris en matière brute.
Le projet Thoravej 29 illustre parfaitement cette dualité : nous avons découpé des éléments de béton existants pour créer un nouvel escalier, tandis que les déchets de bois ont été broyés puis moulés en nouvelles planches pour créer du mobilier. Les déchets métalliques (radiateurs, tuyaux) ont été aussi compressés en cubes, avant d’être sablés pour créer, par exemple, des pieds de table, ajoutant une dimension créative et esthétique unique au nouveau bâtiment. La construction véritablement durable exige cette flexibilité d’approche, où tantôt l’environnement s’adapte au matériau, tantôt le matériau s’adapte à l’environnement.

Vous êtes commissaire de l’exposition « Build of Site » organisée au cœur du chantier de rénovation du Pavillon Danois, à l’occasion de la Biennale d’Architecture de Venise. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce chantier expérimental pour lequel vous vous êtes servis presque exclusivement de matériaux recyclés ?
Le Pavillon danois nécessitait une rénovation urgente pour résoudre deux problèmes majeurs : les inondations récurrentes dues à sa proximité avec le canal vénitien et la fissuration de ses sols provoquée par l’instabilité du terrain. Nous avons saisi cette opportunité pour transformer ce chantier en laboratoire expérimental répondant à une question fondamentale : pouvons-nous révolutionner (vraiment) nos méthodes de construction ?
Avec l’aide d’ingénieurs et de scientifiques, nous avons scanné le bâtiment et son sol, identifié les fissures et analysé les structures. Ces données précises de toutes les composantes présentes sur place nous ont permis de réutiliser de façon créative les matériaux existants : par exemple pour découper des plaques de béton et les réinsérer ailleurs ou extraire des composants du sol que nous avons mélangé ensuite à des substituts végétaux au béton, pour fabriquer le mobilier d’exposition.
L’idée était de voir jusqu’où pouvait aller cette démarche d’autosuffisance d’un bâtiment dans sa propre rénovation. Si l’intégration de certains matériaux neufs (systèmes électriques, liants végétaux) reste inévitable, nous avons voulu repousser les limites de ce concept.

La contrainte d’utiliser principalement les matériaux présents sur place a-t-elle été à l’origine d’innovations techniques ?
Absolument. Nous avons collaboré avec Carlotta Borgatos de l’Atelier Luma (centre de recherche en design basé à Arles en France, explorant les matériaux biosourcés et les pratiques circulaires, ndlr) qui étudie l’utilisation des algues et de l’alginate** comme substitut au ciment. Nous avons extrait de la terre du sol du pavillon, y avons ajouté des alginates, du sable et du papier recyclé pour créer une matière première innovante. Seul l’alginate ne provenait pas directement du bâtiment, mais il est abondant dans la lagune de Venise et son extraction profite aux écosystèmes locaux.
Un autre exemple est le travail de Julian Christ (chercheur allemand spécialisé dans les liants alternatifs au ciment à l’Université technique de Munich, ndlr) qui explore la gélatine végétale comme alternative au ciment. Nous avons ainsi pu fabriquer des plateaux de table en mélangeant du limon*** et du sable trouvés sous le pavillon avec cette gélatine. Les résultats offrent une résistance à la compression comparable au béton traditionnel.
*Dalles TT : Éléments préfabriqués en béton précontraint en forme de double T, utilisés pour les planchers et toitures de grands espaces grâce à leur légèreté et leur grande portée.
**L’alginate : polymère naturel extrait d’algues brunes, utilisé comme gélifiant ou épaississant.
***Limon : sédiment fin et fertile, déposé par l’eau.
Aller plus loin :
Biennale d’architecture Pavillon danois
Retrouvez d’autres articles sur la circularité :
https://wwwconstrucstg.wpengine.com/circularite/
Découvrez notre Dossier « Regards d’Architectes sur la construction durable » :
https://wwwconstrucstg.wpengine.com/regards-darchitectes-sur-la-construction-durable/
Crédits photos: © baubüro in situ, photo: Martin Zeller, hampus berndtson